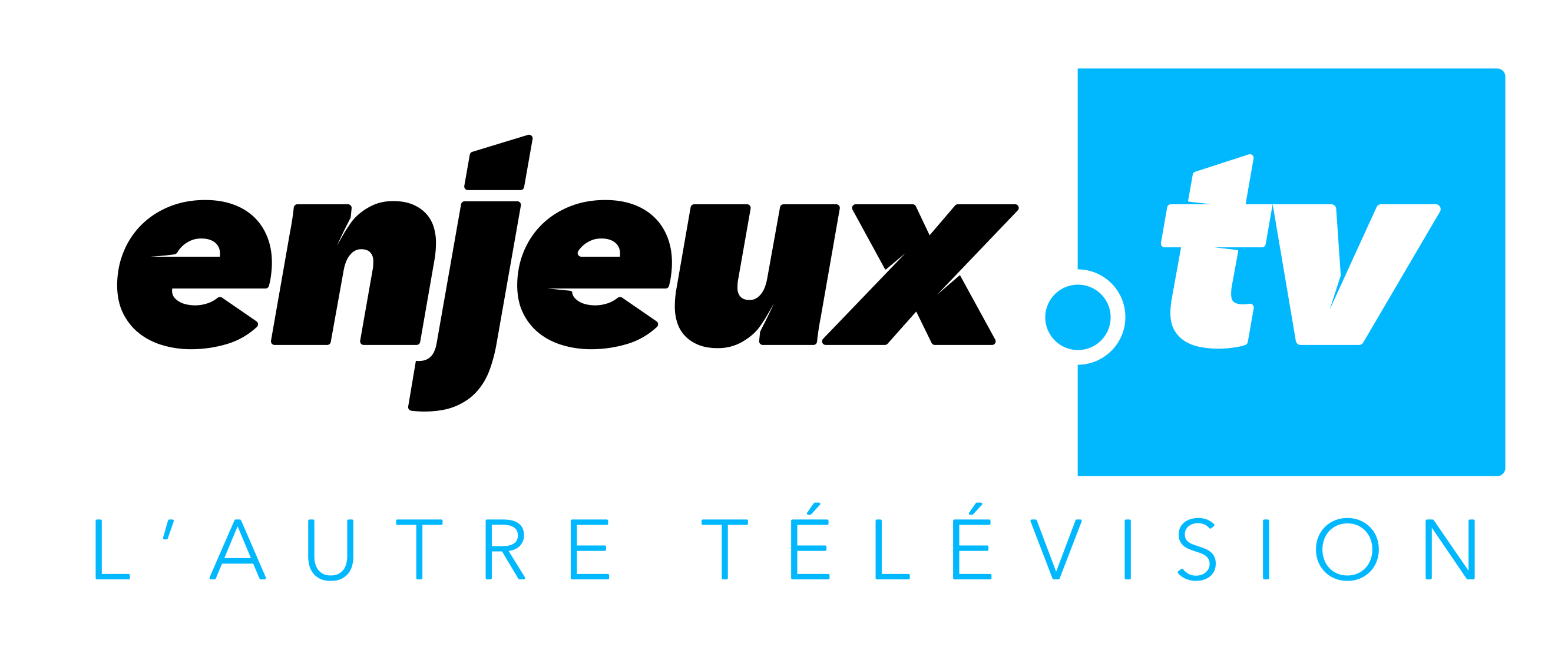L’annonce par Alassane Ouattara de sa volonté de briguer un quatrième mandat relance une vieille inquiétude africaine : celle des présidents qui s’accrochent au pouvoir, au mépris des principes constitutionnels, du renouvellement générationnel et des aspirations démocratiques. Dans un pays encore marqué par des plaies mal refermées, ce choix divise, interroge et secoue à nouveau le socle fragile de la réconciliation nationale.
En Côte d’Ivoire, l’histoire politique semble décidément bégayer. Fin juillet 2025, le président Alassane Ouattara a officiellement annoncé sa volonté de briguer un quatrième mandat. Ce moment politique, chargé de tension symbolique, fait écho à des décennies de glissements successifs, de relectures constitutionnelles opportunes et d’un jeu démocratique de plus en plus verrouillé.
La parole en trop, le silence en moins
Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd’hui que j’ai décidé d’être candidat à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent dont la gestion exige de l’expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays…
a affirmé le chef de l’État. À 83 ans, il estime avoir la « santé ». C’est en ces termes feutrés qu’Alassane Ouattara, 83 ans, a officialisé ce qui, pour certains observateurs, relevait du secret de polichinelle. Dans un discours prononcé depuis Abidjan, le président ivoirien a mis fin aux spéculations sur ses intentions, tout en esquivant le débat constitutionnel sur le cumul des mandats.

La scène, pourtant, semblait familière. Déjà en 2020, après avoir annoncé son retrait, le chef de l’État revenait sur sa décision après le décès brutal de son dauphin désigné, Amadou Gon Coulibaly. La tragédie avait alors servi de justification. Mais quatre ans plus tard, aucune fatalité ne s’est produite sinon celle, peut-être, d’un pouvoir incapable de se penser autrement que vertical, éternel, centralisé.
Les habits neufs de la monarchie républicaine
Il faut le dire sans ambages : le quatrième mandat d’Alassane Ouattara ne s’inscrit pas dans une dynamique démocratique, mais dans une logique de verrouillage. En Côte d’Ivoire, comme ailleurs sur le continent, l’ingéniosité des chefs d’État consiste souvent à « reconfigurer » la légalité à défaut de la légitimité. On ne modifie plus frontalement la Constitution on l’interprète. On ne musèle plus l’opposition on l’absorbe. On ne suspend plus les scrutins on les vide de leur substance.
Et c’est là tout le paradoxe. Officiellement, rien ne s’oppose à cette candidature. Mais moralement, symboliquement, politiquement, elle heurte. Elle sonne comme un désaveu des promesses de transition. Comme un retour à l’autoritarisme rampant. Comme une mise en pause du souffle républicain. La rhétorique du « développement », agitée comme un talisman, ne suffit plus à faire illusion. Car si des infrastructures ont fleuri, si les indicateurs macroéconomiques séduisent, la fracture sociale demeure. La défiance aussi.
Une opposition en miettes, un peuple en attente
Face à Ouattara, qui ? Voilà l’autre drame ivoirien. Car à force d’assécher le débat, de marginaliser les contre-pouvoirs, le régime a contribué à affaiblir toute forme d’alternative crédible. L’opposition, fragmentée, peine à incarner un projet commun. Laurent Gbagbo, toujours influent, reste entravé par son passé. Henri Konan Bédié n’est plus. Les figures émergentes manquent de visibilité nationale ou sont empêchées judiciairement. Dans ce contexte, la candidature d’Alassane Ouattara se présente presque comme une évidence fabriquée. Il est « l’homme de la stabilité », le rempart contre le chaos. Un récit huilé, qui fait fi du coût réel de cette stabilité : répressions ponctuelles, justice sélective, climat politique vicié.

Le peuple, lui, observe. Las, souvent résigné. Car les Ivoiriens n’ignorent rien des conséquences potentielles d’une contestation frontale. L’histoire récente les a marqués au fer rouge. La guerre civile, les exils forcés, les traumatismes non pansés…Mais cette prudence ne vaut pas acceptation. Dans les quartiers d’Abidjan, les murmures montent. Sur les réseaux sociaux, l’ironie fleurit. Et dans les cercles intellectuels, l’inquiétude grandit.

Au-delà d’Abidjan : une alerte continentale
La Côte d’Ivoire n’est pas une île. Le choix d’Alassane Ouattara s’inscrit dans une tendance régionale plus large, où le pouvoir devient un patrimoine personnel. La démocratie devient événementielle, l’alternance une anomalie. Après Paul Biya, Yoweri Museveni, Faure Gnassingbé, Teodoro Obiang ou encore Ismaïl Omar Guelleh, Ouattara rejoint le club très fermé et très controversé des chefs d’État à longévité illimitée. Un club où l’on s’adapte aux lois plutôt que l’inverse. Où l’élection devient une formalité administrative, et non un acte de souveraineté populaire.
Pourtant, ce quatrième mandat ne doit pas être lu uniquement à l’aune ivoirienne. Il envoie un signal inquiétant à l’Afrique de l’Ouest, en pleine recomposition. Une zone en proie aux coups d’État militaires, aux transitions incertaines, aux frustrations démocratiques. La légitimité démocratique, déjà fragilisée, risque d’en sortir davantage érodée. Et les peuples, privés de recours institutionnels, pourraient être tentés par des formes de rupture plus brutales.
La fatigue du pouvoir ou la fatigue du peuple ?
Alassane Ouattara a été Premier ministre, président depuis 2011, bâtisseur, stratège, réformateur. Il aurait pu être celui qui ouvre la voie à une relève apaisée. À une transmission démocratique du pouvoir. Il a préféré réécrire le scénario, se donner un nouveau rôle, dans une pièce déjà trop jouée.
Mais chaque acte supplémentaire affaiblit la dramaturgie. Et à force de prolonger l’intrigue, le héros risque de se confondre avec le tyran. Non pas dans l’intention, mais dans la perception. L’histoire politique est impitoyable avec les hommes qui n’ont pas su s’effacer. La démocratie, elle, ne meurt jamais d’un coup. Elle s’étiole, doucement, dans les applaudissements des fidèles et le silence des institutions.
Alors que la Côte d’Ivoire se prépare à une nouvelle échéance électorale, une question demeure : le président sortant parviendra-t-il à convaincre qu’il est encore le futur ou ne restera-t-il que le passé qui s’obstine ?